Des coques en cuivre à la chimie moderne
Dès l'Antiquité, les navigateurs observent le fouling, c'est-à-dire l'encrassement biologique des coques. Les Égyptiens utilisaient déjà des huiles ou de la cire pour ralentir ce phénomène. Mais c'est surtout au XVIIIe siècle que les choses s'accélèrent : la Royal Navy commence à revêtir les coques de ses navires en bois de plaques de cuivre, un métal naturellement toxique pour les organismes marins.

Ce fut un succès naval majeur : les bateaux cuivrés restaient plus rapides, plus longtemps. Mais ce métal était cher, et difficile à entretenir.
Avec l'essor des bateaux en métal au XIXe siècle, les ingénieurs cherchent des peintures contenant du cuivre ou du plomb pour reproduire l'effet. Le terme "antifouling" entre dans le langage maritime. ...
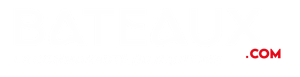
 /
/ 
















