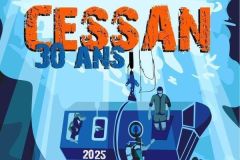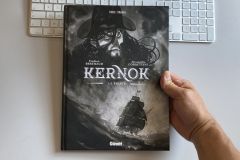Pourquoi les marins buvaient-ils autant d'alcool ?
L'image des marins ivres fait partie de l'imaginaire collectif. Pourtant, cette consommation massive d'alcool à bord n'avait rien d'un simple plaisir coupable. Jusqu'au XIXᵉ siècle, l'eau douce se conservait très mal en mer. Stockée dans des barriques, elle devenait rapidement croupie et insalubre. Pour éviter de boire une eau infectée, les équipages se tournaient vers des boissons fermentées : bière, vin, cidre et, plus tard, rhum et eau-de-vie.
Au 17ᵉ siècle, la Royal Navy et d'autres marines européennes adoptaient des rations d'alcool. Le vin et la bière étaient distribués aux marins en mer tempérée, tandis que le rhum ou l'eau-de-vie devenaient la norme en climat tropical, où la bière se conservait mal. Le vin rouge, en particulier, était privilégié en France, souvent issu des meilleurs crus de Bordeaux.
D'après un journal de bord de 1779, un navire quittant Boston transportait 48 600 gallons d'eau douce contre… 79 400 gallons de rhum ! À chaque escale, il rechargeait ses soutes en vin et whisky, mais l'eau stagnante restait quasi intacte.
La bière, surnommée "liquid bread" (pain liquide), était riche en vitamines B et en calories, tandis que le rhum servait aussi de monnaie d'échange et de stimulant pour l'équipage. Dans certains cas, l'alcool était même un outil sanitaire. Mélangé à l'eau, il permettait d'éliminer certaines bactéries, ...
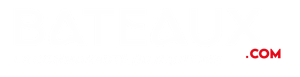
 /
/