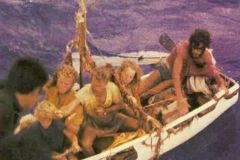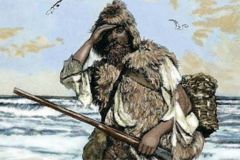En 1629, le Batavia, vaisseau de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, s'échoue sur les récifs des Abrolhos, au large de l'Australie. Ce naufrage, d'abord dramatique, se transforme rapidement en une tragédie d'une toute autre ampleur où se mêlent mutinerie, massacres et terreur. Loin de la gloire promise par sa mission commerciale, le Batavia devient alors le théâtre d'un des épisodes les plus sombres de l'histoire maritime, marqué par une violence d'une brutalité inouïe.
Le Batavia, fierté de la VOC, en route vers l'Orient
Construit en 1628 à Amsterdam, le Batavia est une flûte à trois mâts spécialement conçue pour le commerce au long cours. Avec ses 184 pieds de long (56 mètres), 10,50 mètres de large et un déplacement de 600 tonnes, il représente un chef-d'œuvre technique de son époque, taillé pour affronter les périls des grandes traversées. Ses sculptures colorées, sa coque robuste et ses 24 canons en faisaient à la fois un navire de transport et un bâtiment armé, symbole de puissance.
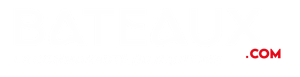
 /
/